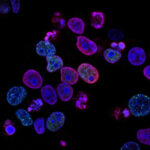Perceptions et sensations en littérature

Marie BIRKEN
Les Carnets de Malte Laurids Brigge, Rainer Maria Rilke (1910)
Les Carnets de Malte Laurids Brigge de Rainer Maria Rilke est un roman se présentant comme le journal intime d’un certain Malte Laurids Brigge. Il vit seul à Paris, au début du vingtième siècle. Ce passage fait partie des premières pages du roman. Le protagoniste décrit les rues de Paris, et plus précisément les bruits qui animent jour et nuit la ville.
Les sensations sont ici décrites comme ce qui s’impose au personnage, semblant subir ses perceptions. La personnification des véhicules s’accompagne de l’évocation de bruits diaboliques, notamment le rire. C’est ici un monde fantasmagorique qui s’impose à l’esprit du personnage. Au procédé traditionnel de la fantasmagorie (projection de figures lumineuses sur une toile, dans l’obscurité) se substitue cependant une projection ‘’sonore’’. Les bruits de la ville se matérialisent et se spatialisent (« des automobiles me passent dessus », « Les tramways électriques traversent ma chambre »).
Le personnage est donc envahi par ses perceptions. L’univers clos de sa chambre, censé symbolisé un espace protégé du monde extérieur devient la caisse de résonnance de tous les bruits de la ville. Les bruits transforment l’espace circonscrit, rassurant et connu de la chambre (ce qu’on pourrait rapprocher du mot allemand « Heim ») en une maison hantée par la polyphonie infernale de la ville, c’est-à-dire en un huis clos angoissant dans lequel s’infiltrent les bruits du dehors et plongent le personnage dans l’étrangeté (« das Unheimliche »).
Ce que cet extrait donne donc à voir, c’est l’impossibilité de se couper de ses perceptions et de ses sensations. Même si le personnage peut refuser de voir en fermant les yeux, il ne saurait se couper complètement du monde extérieur, puisque les sensations auditives s’imposent à lui. Dans cette réalité en mouvement perpétuel, devenant par là étourdissante voire insoutenable pour le personnage, le moi déchiré se trouve confronté à l’étrangeté du monde : « Tout est éphémère, un monde sans substance qui n’est constitué que de couleurs, contours, sons. La réalité est en mouvement perpétuel, en reflets changeants à la manière d’un caméléon. C’est dans ce jeu de phénomènes que se cristallise notre moi. De l’instant de notre naissance à notre mort, il se transforme sans cesse.»1
Bibliographie
- Freud, Sigmund : L’inquiétante étrangeté et autres essais, traduction de Bertrand Féron, Folio essais, Gallimard, Paris, 1985.
- Rilke, Rainer Maria Les Carnets de Malte Laurids Brigge, 1910, traduction de Claude Porcell. GF-Flammarion, Paris, 1995, Pages 24-25.
- Simmel, Georg : « Les grandes villes et la vie de l’esprit », Philosophie de la modernité, I. Traduction de Vieillard-Baron, Payot, 1989.
- Vinas-Therond, Florence : « Quel tempo pour la modernité ? », In : Marie Blaise et Alain Vaillant, Rythmes, Histoire, littérature, Presses Universitaires de la Méditerranée, Montpellier, 2000.